Fiche TDC
I-DIAGNOSTIC
Symptomatologie – TDC
Le trouble développemental des coordinations se caractérise par des difficultés dans l’apprentissage de nouveaux gestes. L’enfant est souvent décrit comme étant “maladroit”. Au quotidien et dans les différents lieux de vie, l’enfant présente des difficultés dans l’utilisation et la manipulation de divers outils :

Ecole
Manipulation des outils scolaires (compas, équerre, règle), dessin et écriture.
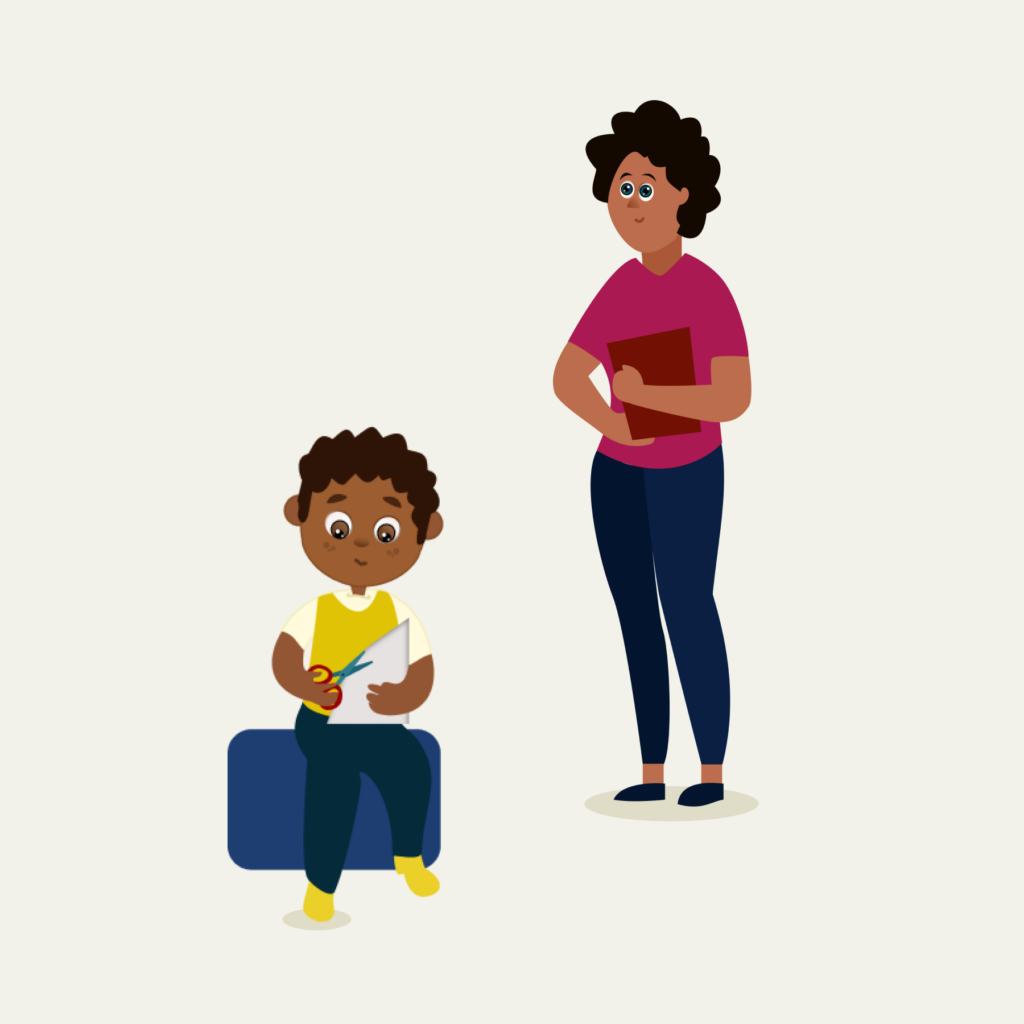
Autonomie quotidienne
Organiser son cartable, tenir ses couverts, s’habiller et se coiffer, faire ses lacets.

Espace
Repérage sur une feuille, lecture de plan, déplacement…

Loisirs
Jeux de manipulation et de construction, danse
Points forts : l’enfant préfère les jeux d’imagination et les discussions. Son langage oral est riche, il aime raconter des récits construits, et présente une bonne mémoire.
D’après la DSM-5, le diagnostic du TDC s’établit selon 4 critères :
- L’acquisition et l’exécution de bonnes compétences de coordination motrice sont nettement inférieures au niveau escompté pour l’âge chronologique compte-tenu des opportunités d’apprendre et d’utiliser ces compétences. Les difficultés se traduisent par de la maladresse (ex: laisser échapper ou heurter des objets), ainsi que de la lenteur et de l’imprécision dans la réalisation de tâches motrices (ex: attraper un objet, utiliser des ciseaux ou des couverts, écrire à la main, faire du vélo ou participer à des sports).
- Les déficiences des compétences motrices du critère A interfèrent de façon significative et persistante avec les activités de la vie quotidienne correspondant à l’âge chronologique (ex: les soins et l’hygiène personnelle) et ont un impact sur les performances scolaires, ou/et les activités pré- professionnelles et professionnelles, les loisirs et les jeux.
- Le début des symptômes date de la période développementale précoce.
- Les déficiences des compétences motrices ne sont pas mieux expliquées par un handicap intellectuel ou une déficience visuelle et ne sont pas imputables à une affection neurologique motrice (infirmité motrice cérébrale, dystrophie musculaire, maladie dégénérative).
Prévalence : Le TDC touche 5 à 7 % des enfants de 5 à 11 ans.
Quels professionnels interviennent dans le parcours diagnostic ?

- Médecins scolaire
- PMI
- Pédiatres

Bilans :
- Psychomotriciens
- Ergothérapeutes
Via quels outils/ bilans :
Médecin : Examen clinique pour exclure tout trouble moteur, orthopédique ou musculaire qui pourrait expliquer les problèmes rencontrés par l’enfant.
ORL : Examen clinique pour rechercher une éventuelle surdité.
Neuropsychologue : Entretien, examen clinique et tests, destinés à étudier le fonctionnement du système nerveux.
Tests psychométriques : Mesurer les compétences et les difficultés de l’enfant. Les tests psychométriques concernent la mémoire à court et à long terme, l’attention, le langage oral et écrit, ainsi que les diverses fonctions cérébrales. Elles précisent les caractéristiques de la dyspraxie et permettent d’élaborer un traitement adapté.
Psychomotricien :
-Entretien avec la famille.
-Echelles de performance comme la M-ABC 2 (Batterie d’évaluation du mouvement chez l’enfant, 2016), le TGMD 2 (Test de Développement de la Motricité Globale, 2018), l’ Échelle de coordinations motrices de Charlop-Atwell (1994), etc.
-Echelles développementales comme la NP-MOT (Batterie d’Évaluation des fonctions neuro-psychomotrices de l’enfant, 2006), les subtests sensori-moteurs et d’imitation gestuelle de la Nepsy II (2012), les volets moteurs de l’échelle des comportements adaptatif de la Vineland 2 (2015), etc.
-Echelle d’évaluation rapide de l’écriture BHK (2004 & 2013 pour enfants & adolescents) permettant de détecter une éventuelle dysgraphie associée.
Ophtalmologue et orthoptiste : Anomalies de la motricité des yeux ou un trouble de la vision.
Orthophoniste : Raisonnement logico-mathématique.
II – RBPP POUR LES PRISE EN SOIN DES TDC
Recommandations de bonnes pratiques concernant le trouble développemental des coordinations :
- Appellation :
Le groupe d’experts recommande d’utiliser de manière privilégiée le terme trouble développemental de la coordination (TDC) dans la recherche et en clinique en lien avec les critères du DSM mais en le considérant comme synonyme de dyspraxie.
- Evaluation :
Le groupe d’experts recommande d’améliorer le diagnostic en permettant une évaluation pluridimensionnelle et individualisée répondant aux critères du DSM à l’aide d’outils standardisés et normés.
Le groupe d’experts recommande de sensibiliser et former les acteurs pour faciliter le repérage et le diagnostic avec des tests standardisés et normés mais aussi favoriser l’inclusion des personnes présentant un TDC.
- Interventions :
Le groupe d’experts recommande de promouvoir et soutenir les interventions visant la participation et la réalisation d’activités socialement significatives en tenant compte de la qualité de vie.
- Scolaire :
Le groupe d’experts recommande de veiller à l’application de la loi de 2005 sur les personnes handicapées pour les personnes présentant un TDC, notamment dans le cadre scolaire.
Le groupe d’experts recommande de développer des travaux en sciences sociales sur les modes de prise en charge et les acteurs.
Le groupe d’experts recommande de développer des recherches sur les situations de handicap
en milieu scolaire pour les personnes présentant un TDC et sur l’école inclusive.
- Développement de la recherche :
Le groupe d’experts recommande de soutenir une recherche de qualité en encourageant les équipes pluridisciplinaires et facilitant l’accès aux données et aux infrastructures nécessaires.
Le groupe d’experts recommande de renforcer les recherches expérimentales et cliniques pour caractériser la grande hétérogénéité du TDC, comprendre les mécanismes et les corrélats cérébraux et génétiques sous-jacents.
Le groupe d’experts recommande de développer des recherches pour mieux cerner les répercussions du TDC sur la participation et le vécu des individus.
Le groupe d’experts recommande de renforcer les recherches sur les adolescents et adultes présentant un TDC.
Le groupe d’experts recommande de renforcer les recherches sur les outils d’évaluation par rapport au TDC concernant les études sensorimotrices, cognitives et les corrélats cérébraux mais aussi la participation et la qualité de vie.
Le groupe d’experts recommande de poursuivre les recherches pour évaluer les interventions les plus pertinentes en fonction des profils et les modèles d’organisation des prestations les plus efficients.
Quelles sont les différents types d’approches recommandées et validées scientifiquement ainsi que les objectifs associés ?
L’objectif est d’améliorer les capacités de l’enfant sur le plan fonctionnel, mais aussi dans ses interactions avec les autres et sur le plan psychologique (meilleure estime de lui, baisse de l’anxiété).
Rééducation individuelle
– Prise de conscience plus efficace de ses propres actions
– Permet de mettre en place des stratégies au quotidien pour connaître son propre fonctionnement.
Exemple de méthodes standardisées : Co-op => Cette méthode se base sur l’approche “top down”.
-Aspect motivationnel. Le sujet est moins anxieux en ce qui concerne l’exécution du geste, ce qui renforce son sentiment de maitrise et sa confiance.
-Avantage cognitif en favorisant la mise en place de stratégies par la répétition mentale du geste et en améliorant l’habileté motrice du sujet.
Exemple de méthodes standardisées : Imagerie motrice => Représentation mentale d’un mouvement ou d’une séquence motrice sans qu’elle soit accompagnée de son exécution. C’est une construction multimodale qui consiste à se rappeler des images mentales déjà perçues ou à anticiper des événements à venir à travers différentes modalités sensorielles. L’activation de la représentation motrice d’un geste est à la base des actes moteurs.
-Les personnages amènent les enfants à porter un regard de métacognition sur leurs tâches mentales.
-Permet de transmettre à l’élève une procédure de travail intellectuel pour l’aider dans ses apprentissages ultérieurs.
Exemple de méthodes standardisées : Reflecto => est une méthode de développement de compétences cognitives où les élèves apprennent à gérer des stratégies en utilisant les qualités et les caractéristiques de sept personnages signifiants : un détective, un explorateur, un bibliothécaire, un contrôleur, un architecte, un menuisier et un arbitre.
-Permet de cibler les modifications à apporter dans l’environnement.
-L’enfant observe le résultat de ses performances.
-L’enfant se concentre sur les instructions et les feedbacks que le professionnel lui fournit.
Exemple de méthodes standardisées : Approche NTT => Neuromotor task training s’appuie sur les théories de l’apprentissage moteur. Elle nécessite une analyse préalable des habiletés motrices dans un domaine donné : identification des processus de contrôle moteur défaillants et qui doivent être travaillés prioritairement. Cette méthode se base sur l’approche “top down”.
-Permet à l’enfant de décortiquer et conscientiser chaque étape de l’action motrice
-Permet à l’enfant d’être de plus en plus autonome en s’appropriant la tâche/ l’action motrice.
Exemple de méthodes standardisées : Programme d’auto – instruction => Cette méthode passe par l’utilisation des verbalisations de l’enfant. Dans un premier temps, l’adulte donne des instructions à voix haute à l’enfant pour l’aider à réguler son comportement moteur. Dans un second temps, l’enfant intériorise les instructions pour contrôler sa propre activité motrice.
Rééducation en groupe
-Développe certaines compétences spécifiques comme l’attention, l’imagerie mentale, la créativité et l’organisation générale du travail.
-Facilite l’apprentissage et la réussite scolaire de l’élève.
-Facilite ses relations aux pairs
Exemple de méthodes standardisées : PIFAM : travail de métacognition => Programme d’intervention sur les fonctions attentionnelles et métacognitives. S’adresse aux jeunes rencontrant un déficit attentionnel, et des difficultés dans les fonctions exécutives en général.
Liens utiles
Ouvrages et formations relatives aux éléments ci-dessus
Ressources aménagements pédagogiques
Faciliter l’écriture manuscrite
Accessibilité des graphiques et tableaux
Soutenir la prise d’indices visuels pour mener à bien une tâche
Rendre accessible l’apprentissage de la géométrie




